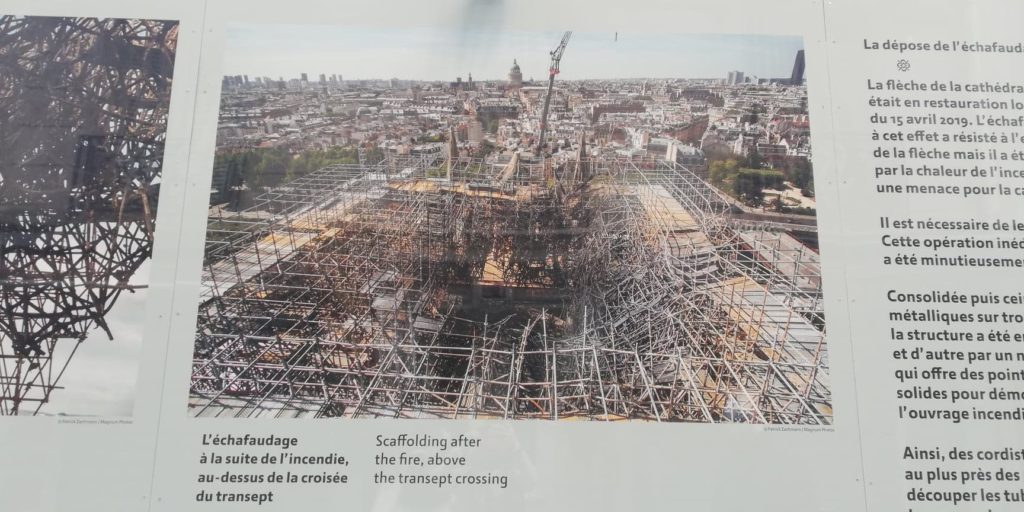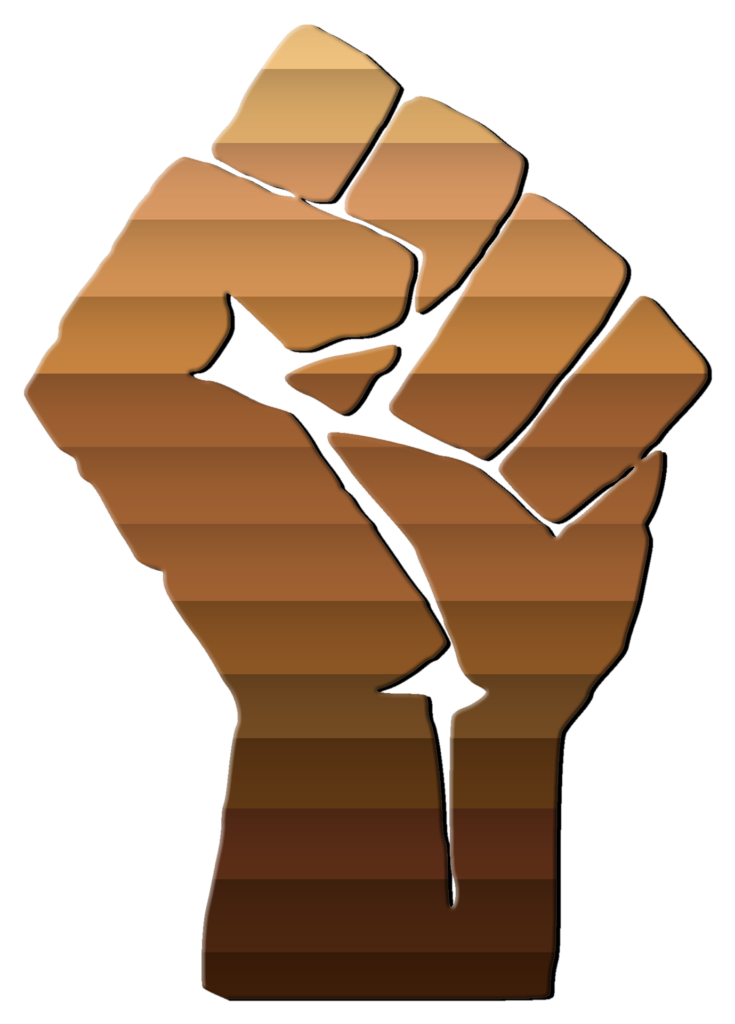Pour le premier avril, nous vous proposons de découvrir une nouvelle zone maritime protégée, réputée pour les poissons qu’elle contient : l’aire protégée des îles Phoenix.
Si la grande barrière de corail est la plus célèbre zone maritime protégée du globe, l’aire protégé des îles Phoenix est quant à elle « la plus grande zone maritime protégée au monde ». Recouvrant 408 250 km², elle se compose de huit îles, de récifs submergés et des eaux environnantes, ce qui correspond à 12% du territoire kiribatien, dans l’Océan Pacifique sud.
Crée en 2006 dans l’espoir d’encourager la communauté internationale à protéger l’environnement, l’aire des îles Phoenix a été inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2010.
L’aire protégée des îles Phoenix est interdite à toute exploitation de ses ressources, ce qui lui a permis de conserver « un des derniers écosystèmes intacts d’archipel corallien océanique de la planète ». En effet, on y retrouve 200 espèces de coraux, 500 espèces de poissons, 18 espèces de mammifères marins et 44 espèces d’oiseaux : poissons requins, tortues de mer, crabes de cocotier…
Le site contient également 14 monts sous-marins, qu’on suppose être des volcans éteints. Ceux-ci font jusqu’à 4 500 mètres d’altitude et 6 000 mètres de profondeur.
Grâce à son isolement, l’aire des îles Phoenix est ainsi un site unique en terme de biogéographie, dans la mesure où il s’agit d’un habitant crucial pour les espèces migratoires et les courants océaniques de la région.
© Conservation.org
Critères de sélection :
Pour figurer sur la Liste du patrimoine mondial, un site doit satisfaire à au moins un des dix critères de sélection. L’aire protégée des îles Phoenix en satisfait deux.
Critère (vii) : représenter des phénomènes naturels ou des aires d’une beauté naturelle et d’une importance esthétique exceptionnelles.
L’Aire protégée des îles Phoenix est une étendue sauvage inhospitalière à la colonisation humaine, minimisant ainsi l’impact des activités humaines. La nature quasiment vierge, la clarté des fonds marins, le spectacle des groupes d’espèces charismatiques, les récifs coralliens d’une beauté exceptionnelle et les concentrations d’oiseaux marins, font de ce bien un véritable kaléidoscope d’une beauté naturelle exceptionnelle, dont l’importance est planétaire.
Critère (ix) : être des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques et biologiques en cours dans l’évolution et le développement des écosystèmes et communautés de plantes et d’animaux terrestres, aquatiques, côtiers et marins.
En tant que lieu de reproduction de nombreuses espèces terrestres et marines, et grâce au haut niveau de biodiversité qui lui est associé, l’aire protégée des îles Phoenix contribue fortement au développement des écosystèmes marins et des communautés végétales et animales de la planète. Ce bien est d’une importance scientifique majeure dans l’identification et le suivi des processus d’évolution du niveau de la mer, les taux de croissance et l’âge des récifs et des coraux constructeurs de récifs et dans l’évaluation des effets du changement climatique.
Gestion du site :
Sur le plan juridique, l’aire des îles Phoenix est protégé en vertu d’un règlement de 2008 qui définit clairement son périmètre, établit son comité de gestion et s’efforce de mettre en place d’un plan de gestion. Le gouvernement de Kiribati s’engage fermement à garantir un système de gestion durable et adapté aux conditions d’un petit État insulaire en développement, notamment en sanctionnant des bateaux de pêche illégale.
Kiribati s’engage à poursuivre le renforcement des capacités de gestion, notamment en matière de surveillance et de respect de la législation, à travers des partenariats régionaux, nationaux et locaux. Le gouvernement de Kiribati veille également à ce que l’interdiction de pêcher dans la région soit respectée.
Les partenaires, comme Conservation International et l’Aquarium de New England, s’engagent quant à eux à assurer la création, le financement global et le fonctionnement du fonds de soutien en faveur du bien.
Cet article n’engage que son auteure.
Mathilde VARBOKI
Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_prot%C3%A9g%C3%A9e_des_%C3%AEles_Ph%C5%93nix, https://whc.unesco.org/fr/list/1325/