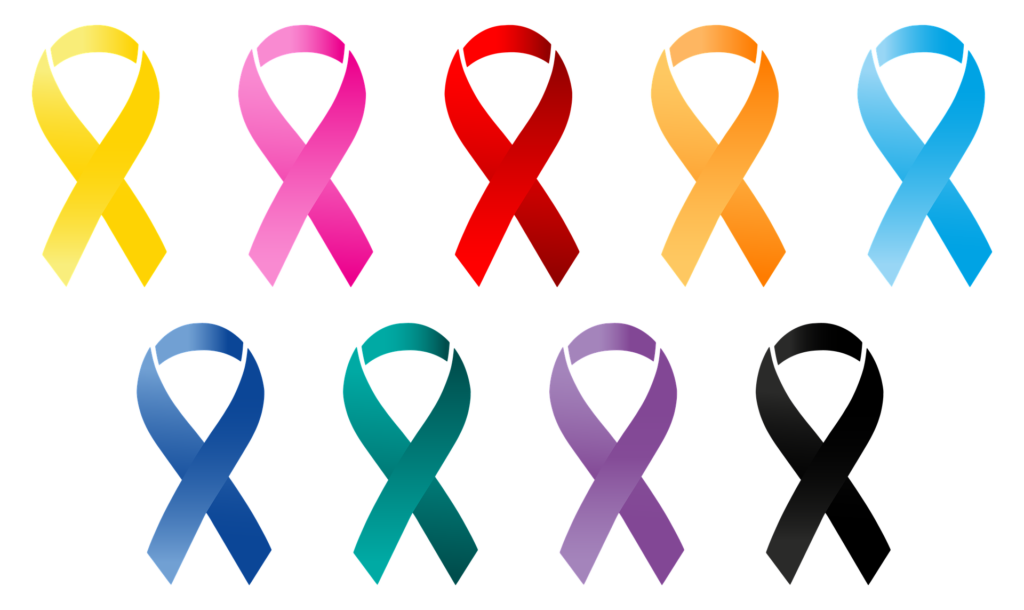Bonjour à toutes et à tous ! Nous sommes ravies de vous présenter enfin le premier podcast de l’antenne UNESCO, à l’occasion de la journée internationale du handicap célébrée le 3 décembre. Un format qui devait voir le jour cette année et prend tout son sens en ce moment pour pallier à différentes rencontres physiques. Dans ses podcasts nous aborderons les thématiques chères à l’UNESCO, dans le but de sensibiliser les étudiants et instaurer un débat, une réflexion autour de problématiques actuelles qui touchent à l’éducation, de la préservation des biens culturels, des sciences etc. Nous allons traiter de la situation des étudiants en situation de handicap dans le système éducatif français, notamment en temps de pandémie. Une thématique sur l’éducation en temps de Covid que vous aurez l’occasion de retrouver prochainement lors d’une conférence organisée par l’antenne. Nous recevons deux étudiantes Héloïse et Mila pour parler de discriminations insidieuses, représentations médiatiques, de biopolitique en cette période de pandémie et d’enjeux professionnels. Nous rappelons que la réflexion menée au cours de ce podcast n’implique que ses protagonistes. Nous vous remercions de votre bienveillance pour ce premier podcast. Encore un grand merci à Héloïse et Mila pour leur témoignage et leur confiance ! Vous pouvez retrouver ce podcast sur de nombreuses plateformes de podcast : Apple Podcasts, Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Overcast, Pocket Casts, Radio Public 🎶.
Anchor: https://d3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net/staging/2020-12-02/586c4a4e3839d9b1ac5599b75d4f9914.m4a?fbclid=IwAR1AHukfI35J6DSa1MN3oOvzmtNhQYmAUQjRDV8P_c-r6HcRyFVWa73-MMM
Spotify: https://open.spotify.com/episode/4GiFdB2gbPgPAg9wtdKXJj?si=qC3W_g23TDib-YPk2czTQw&fbclid=IwAR10py3nfTzybW1tiyFCT9GLDgjK4TVdabAkbtq1lwxmx11SV76j1PZ27ds
Bonne écoute !
👉Pour aller plus loin :
- Le documentaire Crip Cramp sur Netflix sur l’émergence aux États-Unis de la lutte pour les droits des personnes handicapées
- Lire Michel Foucault sur la normalité, la pathologie et le biopouvoir
- Voir le programme de l’UNESCO sur les personnes en situation de handicap
👉 Version script podcast : UNESCO à l’antenne #1 : Être étudiant.e.s en situation de handicap 📻
Mariette : Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Mariette Boudgourd, en charge de la réalisation de ce premier podcast de l’antenne UNESCO de SONU. Un format qui devait voir le jour cette année et prend tout son sens en ce moment pour pallier à différentes rencontres physiques. Dans ses podcasts nous aborderons les thématiques chères à l’UNESCO, dans le but de sensibiliser les étudiants et instaurer un débat, une réflexion autour de problématiques actuelles qui touchent à l’éducation, de la préservation des biens culturels, des sciences etc.
Aujourd’hui nous allons parler d’éducation : puisque si l’on veut édifier des sociétés du savoir inclusives, et un accès à l’information et au savoir est essentiel pour permettre à tous les citoyens de devenir des membres créatifs et productifs de la société. Il est néanmoins important de noter quel type de discriminations touchent les personnes en situation de handicap et noter les enjeux que celles-ci supposent. C’est pourquoi à l’occasion de la journée internationale du handicap, célébrée par l’UNESCO tous les 3 décembre et ce depuis 1992 : nous allons traiter de la situation des étudiants en situation de handicap dans le système éducatif français, notamment en temps de pandémie. Une thématique sur l’éducation en temps de Covid que vous aurez l’occasion de retrouver prochainement lors d’une conférence organisée par l’antenne. Avant toute chose, je rappelle que la réflexion menée au cours de ce podcast n’implique que ses protagonistes. et je vous remercie de votre bienveillance pour ce premier podcast. Donc aujourd’hui je reçois deux étudiantes, ou plutot une étudiante et une jeune active : Mila pour parler de Accès à l’enseignement, de discrimination et des enjeux de ses exclusions pour les personnes en situation de handicap dans l’insertion professionnelle.
Mariette : J’espère que vous allez bien toutes les deux et je vais vous laisser vous présenter :
Héloïse : Alors moi je m’appelle Héloise, je suis sourde profonde bilatérale et j’étudie donc dans une école de sciences sociales et voilà après je vis plutôt bien avec mon handicap pour l’instant
Mila : Moi c’est Mila, je suis infirme moteur cérébral ou paralysé cérébral cela a deux noms. Je me déplace uniquement en fauteuil électrique ou manuel. J’ai fait des études de psychologie clinique et je viens d’être diplômée. Et par rapport à mon handicap c’est plus apaisé qu’avant mais ça veut dire que j’ai encore du chemin à faire.
Mariette : D’accord donc on va commencer avec une question assez large puis on va réduire la focale ensuite : Quel type de discrimination peut-on relever dans l’enseignement supérieur par rapport à vos expériences ? On peut éventuellement parler aussi d’intégration sociale ! Je ne sais pas qui veut commencer peut-être Mila..
Mila : Pour ma part, les discriminations ont été moins nombreuses dans l’enseignement supérieur qu’elles ne l’ont été au lycée et au collège. Par exemple, à l’université, je connaissais dès le début les aménagements que j’allais avoir, comme une table de travail devant dans l’amphi , le tiers temps pour les examens, et j’ai pu choisir mes cours et faire mon emploi du temps avant les autres étudiants. Vu que j’ai une très grande fatigabilité, ça me permettait d’aménager mes cours plus tard dans la journée et de me lever plus tard.
Mariette : Et cette organisation marche- elle vraiment bien à l’université ?
Mila : Oui c’est vraiment mis en place, dans le sens ou il y a des étudiants qui sont payé pour prendre les cours pour vous et vous les envoyer. Ce qui n’est pas idéal c’est qu’ on ne choisit pas l’étudiant en question.
Mariette : Il n’y a pas de vérification des cours ?
Mila : Non, du tout.
Mariette : Dans tous les cas, ton quotidien doit être très fatigant… le fait de devoir changer de salles de TD tout au long de la journée.
Mila : Oui
Mariette : Et toi Héloïse ?
Héloïse : Alors par rapport à la question de savoir s’il y a plus de discriminations dans l’enseignement supérieur, je dirais que c’est assez mitigé parce que, il y a des discriminations dans le secondaire au Lycée, le truc c’est que dans l’enseignement supérieur on les retrouve mais on a plus de marge de manoeuvres pour les réduire, c’est à dire qu’on a beaucoup plus de droits, en terme de compensation, de moyens qui sont mis en place et du coup, les effets des discriminations s’en trouvent diminués. C’est vraiment une chose que j’ai remarquée en entrant dans les études Sup. Après, personnellement je suis dans une école qui a beaucoup de moyens financiers pour ses étudiants en situation de handicap et donc c’est vrai qu’il mettent beaucoup de choses en place. J’ai oublié de préciser dans la présentation de mon handicap, c’est que je suis appareillée à droite, ce qui me permets d’avoir une petite récupération auditive et je m’appuie essentiellement sur la lecture labiale. Donc par exemple dans mon école, ils ont mis en place un dispositif de saisie de texte, la vélotypie, qui permet le sous titrage en direct, comme vous avez pu le voir lors des discours officiels pendant le confinement. C’est un dispositif qui coûte très cher, environ 250 euros de l’heure et j’en bénéficie pour mes cours. C’est vraiment un luxe mais malheureusement des problèmes de coordination entre la cellule handicap, la régie, le professeur et le transcripteur font que parfois je n’ai pas le cours en temps réel. C’est pareil pour les preneurs de notes, suivant leur bonne volonté, parfois j’ai des copiés-collés des diapos et même en leur expliquant que ça n’est pas de la prise de note, ils font mine de ne pas comprendre. C’est plus une question de relation humaine mais après ce que je trouve compliqué dans la prise de note, c’est qu’on a un preneur de note différent par cours. Donc pour moi qui avait 8 cours différents en deuxième année, j’avais 8 preneurs de notes et donc 8 façons de prendre des notes différentes, 8 manières d’utiliser les abréviations différentes et que ça se répète à chaque semestre. Là je suis en troisième année ce qui fait 8×4 preneurs de notes différents. C’est une acclimatation qui au début est très compliquée à gérer et qui est très fatigante. Après concernant les discriminations, j’ai eu beaucoup de problèmes par rapport aux professeurs surtout. Des professeurs qui ne veulent pas porter mon micro HF (haute fréquence) connecté à ma prothèse qui me permet de mieux entendre. Concrètement c’est comme un collier qui se porte autour du cou, ça ressemble en gros à un mini portable. Donc beaucoup de professeurs qui ne veulent pas le porter.
Mariette : Et ca tu penses que c’est dû à un manque d’information, ou juste de la négligence de leur part ?
Héloïse : Les deux, il y a des professeurs qui ne veulent pas le porter parce qu’ils pensent que ça enregistre leur cours, donc je leur explique que non et donc ils acceptent de le porter et après il y a des gens qui refusent parce que ce n’est pas esthétique, on me l’a déjà dit, d’autres professeurs qui oublient, ça les saoulent, ça les encombrent plus qu’autre chose..
Mila : Ce n’est pas dans leur tête, il faut comprendre qu’ils n’ont pas le handicap à l’esprit, ce qui est quelque chose de normal, mais du coup, ça ne fait pas partie de leur priorité et donc ils ont tendance à oublier.
Mariette : C’est quasiment en impensé..
Héloïse : C’est ca c’est ce qu’on se disait avec Mila, quand on en a parlé l’autre jour, c’est que la plupart du temps dans l’enseignement supérieur, c’est qu’on subit des discriminations, mais ce ne sont pas des discriminations par l’action, c’est à dire une personne qui va nous dire, ah tu es en fauteuil roulant, ben je ne vais pas te pousser pour t’embêter, ou je vais te pousser dans l’escalier, ou pour moi c’est pas, ah t’es sourde donc je vais te parler de dos pour pas que tu puisses me comprendre. Ce n’est pas ça, mais en fait ce sont des discriminations dites par omissions, c’est à dire qu’on va oublier (notre handicap) ce qui abouti à une situation de discrimination après et …
Mariette : c’est en plus difficile à…
Héloïse : c’est très insidieux en fait, les discriminations..
Mila : C’est très compliqué à expliquer à la personne, ensuite le but n’est pas de critiquer du tout les personnes valides, ce n’est pas ça, c’est un problème qui est plus général de société, tu vois, mais à force dans l’enseignement supérieur ça devient fatigant. Déjà les études c’est fatigant de base, mais voilà quand ça s’ajoute en plus ça peut vite faire une charge mentale assez importante.
Héloïse : du coup ce que je trouve assez compliqué c’est que c’est toujours à l’étudiant en situation de handicap, d’expliquer son handicap au preneur de notes et ça prend du temps. Ça prend vraiment beaucoup de temps et c’est normal, la personne peut avoir du mal à comprendre pourquoi il doit prendre des notes. Du coup il faudrait plus de formations en amont pour les preneurs de note de la part du service handicap, qu’ils donnent une fiche récapitulative. Parce que quand on est en situation de handicap et étudiant, on a la gestion des études d’une part, la gestion du handicap en tant que tel et de comment s’inscrire dans un environnement pour un étudiant en situation de handicap c’est une autre gestion qui est énorme et largement sous estimée et qui peut parfois être trop importante parce qu’on est pas assez soutenu par l’environnement, par les acteurs qui nous entourent et qui parfois font qu’on est obligé d’arrêter nos études et de faire une pause etc. Mais quand je parle de l’environnement, c’est vraiment l’environnement universitaire, pas du tout la famille, par exemple ma famille au contraire c’est eux qui vont m’aider à avancer et à mettre de l’ordre dans tout ça , mais c’est par exemple la gestion de l’environnement. Par exemple, j’ai un nouvel emploi du temps, il faut que je m’assure que les salles où je suis, soient de bonne taille pour ne pas que cela raisonne et que je n’entende rien. Parfois je me retrouve dans des salles où je n’entend rien du tout et du coup je dois retourner voir l’administration et demander que le cours soit changé de salle etc. On a un système de boucle magnétique qui est un autre système pour transmettre le son dans les prothèses auditives mais parfois sur 3 amphis seul deux en sont équipés et malheureusement tous les cours ont lieu dans la salle qui n’est pas équipée. C’est ce qui me fait dire que certaines choses sont mises en place mais elles ne sont pas effectives, et ça reflète que le handicap ne rentre pas dans les mentalités. On met des besoins matériels, on met de l’argent et on pense que ça va se résoudre comme ça et résoudre le handicap par le matériel ce n’est pas suffisant. Il y a aussi des pratiques qui sont à mettre en place, des points au niveau du comportement sur lesquels il faut faire attention, et par exemple par rapport au preneur de notes, tous les jours je dois essayer de me souvenirs s’il m’a bien envoyé les cours, s’il ne l’a pas fait je doit le relancer, et parfois son cours n’est pas clair, car il me l’a envoyé sans le relire. Il faut toujours repasser derrière et ça c’est très long, très lourd.
Mariette : Donc finalement, si je comprends bien, le plus difficile ce n’est pas le manque de matériel mais plus la charge mentale qu’il y a derrière, parce qu’il n’y a personne pour tout coordonner pour que cela soit simple …
Mila : la charge mentale vient du fait qu’il y a une mauvaise organisation de base tu vois.
Mariette : D’accord, OK. Heu, ce qui m’amène à une question qui est assez liée, mais est-ce que vous auriez des suggestions d’aménagements supplémentaires, plutôt en termes d’accompagnement du coup ?
Mila : Alors moi j’en ai une, déjà autoriser l’AVS (rires) en fac en fait, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, l’AVS c’est l’assistante de vie scolaire. C’est une personne qui accompagne la personne en situation de handicap pendant le cycle du primaire jusqu’au lycée, pendant toute la journée d’école. Son rôle va de la prise de notes des cours et par exemple pour moi, enlever et mettre mon manteau, pour la cantine, elle m’aidait à porter mon plateau. C’est une personne qui est là pour ça, qui est payée pour ça et qui est formée pour ça. Donc il y a moins besoin d’expliquer surtout si la personne est la même continuellement, ce qui n’est pas toujours le cas. mais à la fac, il faut savoir que cela n’existe pas. ce n’est plus autorisé. Il faut savoir que l’État considère qu’ à partir des études supérieures, on n’est plus dans le système scolaire, on est dans les études supérieures, et c’est autre chose. Alors moi j’ai pu aller à la fac sans parce que je m’étais bien au fait qu’après la terminale il n’y allait pas y en avoir et qu’il fallait que je m’habitue à enlever et remettre mon manteau seule à demander de l’aide à la cantine. Mais il faut savoir qu’il y a des étudiants qui ne peuvent juste pas faire des études supérieures parce qu’ils n’ont pas d’AVS et ça pour moi c’est une honte en fait. Je comprends que cela coûte de l’argent parce que du coup c’est l’Etat qui fournit l’AVS mais pour moi c’est une nécessité absolue d’avoir à disposition des personnes pour nous aider.
Par exemple, j’ai connu une personne à la fac qui demandait a sa propre sœur de venir l’aider dans ses journées de fac. Sa sœur avait arrêté de travailler pour venir aider cette personne à suivre ses études.
Mariette : alors que c’est un service qui est un métier à part entière ?
Mila : (sourire) c’est ça ! Les personnes ne font pas ça bénévolement, elles sont payées pour faire ça donc, ça permettrait aussi de créer des emplois. Pour moi c’est quelque chose de primordial.
Mariette : En tout cas, ça aurait permis une meilleure réussite pour vous, moins d’angoisse en tout cas !
Mila : Complètement, ça m’aurait permis d’être moins fatigué pendant mes années de fac !
Mariette : Ça s’est sur !
Héloïse : Moi j’avais une autre suggestion concernant les aménagements que l’on pourrait proposer. Je suis d’accord avec Mila, par contre maintenant l’AVS ça s’appelle AESH, un nom qui a changé pour pas qu’il y ait de confusion. Mais oui les AESH ça serait vraiment à l’université parce que certes Mila et moi on s’en est assez bien sorties pendant les études mais il faut voir à quel prix on s’en est sorti. Il faudrait embaucher davantage d’agents en charge du service handicap. Par exemple moi dans mon école il y a une seule personne qui gère tous les aménagements de tous les étudiants en situation de handicap. Or on est 10 000 étudiants dans cette école, c’est beaucoup trop pour une seule personne. Cela coûte cher c’est vrai mais il y a une expression que j’aimais bien de Jérémie Boroy un membre du Conseil national consultatif des personnes en situation de handicap “Certes l’inclusion pour les personnes en situation de handicap coûte cher mais leur exclusion coûte encore plus chère”. Donc on a tout intérêt à investir parce qu’on apporte des compétences..
Mila : Je suis en train de penser à autre chose, cela peut aussi venir des professeurs. J’ai eu une expérience très positive avec l’un d’eux qui a proposé de lui-même une adaptation des formats d’examens aux personnes handicapés. Dans ce cours nous étions deux en situation de handicap : moi et une personne malvoyante, l’examen a été passé à l’oral pour elle sans qu’il ne soit passé par le service handicap. Il y a aussi ce genre de choses qui peuvent aider.
Mariette : Je me rappelle moi aussi d’un de mes professeurs d’histoire qui lui était complètement désemparé face à une étudiante aveugle. Il n’y avait aucune coordination entre les professeurs et le service handicap à ce moment-là.
Mila : C’est vrai, ça dépend vraiment des cas…
Mariette : On pourrait parler de ça aussi du sentiment de culpabilité constant au quotidien que cela implique.
Mila : Alors de toute façon je trouve que le handicap s’accompagne d’un complexe du fardeau c’est l’idée qu’on est un fardeau et qu’on complique la vie des gens par notre présence. C’est quelque chose que j’ai beaucoup ressenti dans ma scolarité en général et dans la fac particulièrement. Il faut gérer ça au quotidien, c’est vraiment pas le truc le plus agréable à ressentir. Quand on te le fait ressentir vraiment beaucoup c’est pas cool.
Mariette : Le fait même qu’il n’y est pas d’organisation, de coordination entre les professeurs et l’administration vous fait ressentir comme un fardeau. Comme si vous deviez vous battre !
Héloïse : Moi par rapport au complexe du fardeau je l’ai beaucoup plus ressenti au collège et au lycée plus jeune. Mais la fac non, ça a été pas un révélateur mais en tout cas un moyen de mieux connaître mes droits. Parce qu’en fait au collège et au lycée on ne m’a jamais dit ce à quoi j’avais le droit alors qu’à la fac on me l’a clairement dit ! Et puis le fait d’avoir le droit à plus de compensation on prend plus conscience de notre condition, tandis qu’au lycée on néglige notre handicap, on l’efface comme si on était des lycéens comme les autres. C’est plutôt l’effet inverse ducoup que ça m’a fait !
Mariette : D’accord, ok.
Mila : C’est vraiment l’inverse pour moi c’est marrant ! Enfin pas totalement parce que le fait qu’au collège et au lycée on fasse comme si je n’avais pas handicap je l’ai connu. Mais par contre je connaissais déjà mes droits, j’étais assez soutenue et puis les compensations elles étaient présentes parce qu’au collège et au lycée j’étais suivie dans un endroit qui s’appelle le CSAD. C’est un lieu de rééducation ou tout est centralisé donc j’avais toutes mes rééducations au même endroit. Et c’était aussi une équipe qui était là pour me suivre dans mon quotidien et dans ma scolarité. En fait au collège et au lycée il existe quelque chose qui s’appelle le PAI, le projet d’accompagnement individuel qui est mis en place au début de l’année sauf que là c’est fait en équipe pluridisciplinaire donc avec les professeurs, les rééducateurs, les médecins, des représentants du système scolaire français… Et ça me donnait vraiment l’impression d’être prise en charge, d’être accompagnée. L’AESH aidait aussi énormément à ça.
Héloïse : Comment ça s’est passé quand tu as arrêté le CSAD et que tu es retournée en inclusion ?
Mila : En fait j’ai arrêté le CSAD à mes dix huit ans donc à la fin de mon lycée.
Héloïse : Ok, d’accord !
Mila : Donc ça coïncidait avec mon entrée à la fac si tu veux
Héloïse : Là en fait c’est quelque chose dont on voulait parler avec Mila mais qui est importante à préciser c’est que nos parcours scolaires ne sont pas du tout représentatifs de la diversité des parcours des étudiants en situation de handicap. En France il y a un peu trois types de parcours quand on est en situation de handicap : soit on va être dans un établissement spécialisé où on ne va pas être du tout en inclusion avec les personnes valides.
Mila : Moi c’est ce qui est arrivé de mes 3 ans à mes 8 ans par exemple.
Héloise : Voilà, donc ensuite il existe une solution hybride où l’on est dans une classe spécialisée intégrée dans un établissement de personnes valides. C’est par exemple le cas des CLIS, ULIS ou des classes rattachés à l’école ordinaire. La troisième solution c’est l’intégration inclusive complète où là on est dans une classe ordinaire de manière individuelle. Et donc moi j’ai toujours été dans une classe ordinaire complète.
(interlude musicale)
Mariette : Ces deux témoignages illustrent la diversité des parcours et des situations que cette question soulève. En effet depuis la loi de février 2005 l’orientation et les aides accordés aux jeunes en situation de handicap sont prescrites par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées : la CDAPH. Celle-ci se charge d’organiser des projets personnalisés de scolarisation. Or cette scolarisation peut se dérouler en deux types de milieux : soit le milieu ordinaire soit un établissement spécialisé…
(interlude musicale)
Héloïse : voilà ça joue beaucoup sur ce qu’on dit
Mila : Moi je suis passée d’un établissement où j’étais uniquement avec des personnes en situation de handicap à un CSAD à partir du CM1. Alors que Héloise n’a pas le même parcours, ce qui donne des situations complètement différentes et des visions de l’intégration totalement différentes.
Mariette : Mais ça implique aussi Mila peut être que tu te sentes plus perdue dans la masse universitaire ensuite…
Mila : Ouais ! Après ça n’empêche que j’ai reçu une aide des étudiants, de mes ami.e.s. Enfin par exemple je n’avais pas de preneur de note mais par contre parfois les profs sont très rapide en amphi et je suis plutôt rapide mais des fois ou je suis vraiment fatiguée je m’arrête. Et ça m’arrivait régulièrement de demander à une amie “voilà est ce que tu peux me passer le cours à ce moment là”. Et elle le faisait comme une preneur de note sauf qu’elle n’était pas payée et qu’elle était juste sympa (rires) !
Mariette : (rires) Heureusement un peu de solidarité quand même !
Héloïse : Voilà mais ça pour moi c’est un avantage de l’enseignement supérieur c’est la solidarité par rapport au collège et au lycée. C’est de pouvoir demander de l’aide !
Mariette : Ok..Maintenant ce qui m’intéresse c’est de savoir si la politique sanitaire agit comme un biopouvoir, au sens foucaldien, dans le sens où elle pathologise encore plus les personnes en situations de handicap, “hors normes” ? Par exemple par un masque qui ne permettrait pas de voir les lèvres…
Héloïse : Oui (rires) ! Bah alors moi le Covid c’est vrai que ça a changé beaucoup de dimensions dans ma vie personnelle et étudiante. D’une part dans la vie professionnelle le fait que les masques soit obligatoire sur les lieux de travail c’est quelque chose de très compliqué à gérer. C’est à dire qu’on est un peu coincé de partout : lire sur les lèvres sur un zoom c’est très compliqué donc déjà les cours en ligne c’est pas top ! Quand mon école m’a dit la troisième année ça sera tout en ligne j’ai beaucoup insisté pour faire un stage parce que je voulais pas revivre ce que j’avais vécu pendant le premier confinement, qui m’avait malgré les aménagements beaucoup fatigué. Donc je me suis mise en quête d’un stage, et pendant ma recherche cet été le gouvernement a annoncé le port du masque obligatoire sur les lieux de travail. Et à ce moment-là je me suis dit que ça allait être très compliqué ! Quand c’était dans les transports passe encore, parce que ce n’est pas dans les transports qu’on fait nos meilleurs amis en général ! Donc je me suis dis que ça allait être très compliqué et c’est là où j’ai vu à quel point les discriminations étaient accentuées c’est quand j’ai postulé pour une très grosse association humanitaire en France dont je ne dirais pas le nom. Mais qui est très réputée mondialement et réputée pour être très militante et inclusive, et quand j’ai passé l’entretien après un CV. Ils m’ont rappelé en me disant “vous étiez notre candidate préférée, avec le meilleur profil vraiment il correspond pile poil à notre recherche et la personne qu’on a prise correspond moins bien. Mais voilà quand vous nous avez dit que l’on aurait sans doute besoin des masques transparents et que vous étiez sourde on s’est dit que ça ne serait pas possible.. Revenez après la pandémie, on garde une place pour vous.” Il faut savoir que je leur avais vraiment proposé plein de solutions, si ce n’était pas possible les masques transparents comme mettre d’autres choses en place. C’était un travail avec des réfugiés qui ne parlaient pas forcément français donc j’ai dit c’est le moment d’utiliser de nouvelles manières de communiquer. Par exemple les pictogrammes, les tableaux blancs, les dessins donc vraiment j’ai réfléchi au sujet et ils m’ont répondu que c’était trop compliqué et trop cher. Ils avaient déjà eu du mal à trouver des masques par l’état. Donc voilà donc ça c’était vraiment, bah le premier exemple type de la discrimintation a cause des masques. Alors qu’ aujourd’hui les masques transparents sont remboursés par l’Agefiph et le FIPHFP qui sont les plus gros organismes en France pour le secteur privé et public qui remboursent tout le matériel technique qui est censé compenser les situations de handicap. C’est vrai qu’ avant cette crise du covid 19 je n’avais pas tellement peur pour mon parcours professionnel parce que les gens savaient que j’étais sourde mais ils reconnaissaient quand meme mes compétences et la c’est vrai que ca bloque beaucoup plus. Donc je ne sais pas si les masques vont rester obligatoires. Mais si ça reste ça va être beaucoup plus compliqué qu’avant.
Mariette: Mais au fur et à mesure de la pandémie tu as remarqué quand même un effort au niveau des masques ou pas ?
Héloïse : C’est à dire que finalement les gens sont compréhensifs, quand je leur dit je suis sourde je lis sur les lèvres est ce que tu peux baisser ton masque, ils le laissent donc il y a pas de problème par rapport a ca ? En fait tout le monde le sait mais il n’y a pas d’actes donc c’est un peu une logique qu’on retrouve tout le temps dans les situations des minorités.
Ils disent “oui, oui on comprend” mais y’a pas d’actes derrières donc pour nous la compréhension c’est pas suffisant et il faut faire des choses concrètes et typiquement le fait que les masques ne soient pas diffusés de manière massive et tres generale et que la question du handicap ne soit pas parvenu plus rapidement et de manière aussi importante, ça dit beaucoup de chose de comment on considère le handicap dans nos sociétés. Mais attention il faut faire attention, le discours des personnes sourdes et malentendantes qui disent le masque ca exclut toute une partie de la population c’est pas du tout un discours anti masque. On est d’accord que c’est nécessaire de porter le masque, on veux juste qu’il soit inclusive, donc porter un masque mais qu’il soit transparent et globalement c’est un peu dire a toute une partie de la population on sait que vous existez mais on va rien mettre en place pour vous donc débrouillez vous et ca symboliquement c’est assez violent.
Mariette : Et ce qui cause un problème c’est qu’ en face les associations et les institutions ne sont même pas en mesure de proposer une alternative.
Mila: Mais apres ca ca ne l’ai pas parce que de manière générale on est une minorité en fait.
Mariette: Oui c’est ça c’est que de toute façon vous avez des difficultés pour vous faire entendre donc dans cette situation évidemment c’est pareil.
Et du coup on peut parler de votre insertion professionnelle parce que la on a parlé des stages mais j’imagine qu’ en terme de projection dans l’avenir c’est compliqué.
Mila: Oui, moi j’ai fini mes études en juin, et j’ai fait deux stages un en master 1 et un en master 2 déjà donc ça m’a donné une bonne idée de ce qu’allait être la recherche d’emploi dans le futur. Il faut savoir que la recherche de stage est compliquée de manière générale pour tout étudiant, en tout cas de ce que je connais en psycho c’est compliqué.
Mais pour les étudiants handicapés il y a une couche en plus qui s’ajoute parce que déjà mettons qu’on envoie des candidatures à 200 structures différentes sur les 200 il va y’en avoir un tiers voir la moitié qui vont nous dire qui sont pas accessibles. Donc ça enlève beaucoup de possibilité et il faut se dire que ce sont des structures qui pourraient nous accueillir en tant que professionnels plus tard, ce n’est pas que pour les stages. Je pourrais potentiellement postuler là bas aujourd’hui en tant que psychologue diplômée.
Mariette : Même dans des établissements médicaux…
Mila : Oui Oui, par exemple, j’ai déjà eu un hôpital qui m’a dit que ca n’était pas accessible et j’ai halluciné. Je leur ai dit vous êtes un hôpital c’est-à- dire que le but c’est que vous puissiez accueillir des personnes qui sont diminuées physiquement donc il y a une logique qui n’est pas présente. Après ils peuvent être accessibles et donc ils vont me recevoir en entretien et tout de suite ils vont me dire : « Premièrement nos toilettes ne sont pas adaptées”. Donc forcément ça veut dire, super, je vais passer des journées de sept heures a pas aller aux toilettes. Ou alors des entretiens ou on a pu me dire: “Mais du coup vous par rapport à votre handicap comment allez-vous gérer ça par rapport à votre pratique de la psychologie ?” Ils me disent ça comme si je n’étais pas au courant que j’étais handicapée. Je sais que je suis handicapée et si je suis allé dans ce champ d’activité c’est que je sais que je peux gérer mon handicap par rapport à la pratique de la psychologie donc la question n’a pas de sens pour moi. C’est des questions qui reviennent en permanence et donc ils nous renvoient en permanence à votre handicap dans l’exercice de notre métier ce qui ne devrait pas être le cas parce que l’important c’est comment on exerce notre métier et si on est un bon psychologue et si on est capable de suivre des patients. Après il ne faut pas non plus nier le handicap. C’est -à -dire que le handicap est présent, le handicap est là on ne doit pas l’oublier. Surtout dans le domaine de la psychologie, le handicap va pouvoir impacter le patient possiblement. C’est à dire que le handicap souvent ca fait peur donc les patients possiblement ca va leur renvoyer quelque chose de négatif mais dès qu’on a conscience de ce genre de chose le problème est résolu.
Héloïse : Petit aparté la mention ou l’étude du handicap de manière générale et très très peu présente dans les études supérieures sauf si on se dirige vers des métiers d’éducation spécialisé ou qui nécessite de prendre en charge des personnes en situations de handicap. Essayez de vous souvenir d’un cours qui en parle, ça n’existe pas ! Les discriminations ça vient aussi de l’éducation qu’on nous dispense.
Mariette : oui c’est ça ! Je le vois vraiment en histoire où c’est vraiment les grands absents bon déjà on parle jamais vraiment des femmes mais ça c’est un autre problème..
Mila : Ah ouais c’est intéressant !
Héloïse : c’est ça et puis ça fait que ducoup le fait d’étudier le handicap comme un objet d’étude de sciences sociales parce que ça l’est vraiment aujourd’hui. Et bah en France ça ne l’est pas du tout alors qu’aux Etats Unis ou en Angleterre les disabilities studies sont très développées. Et en France le fait que ca ne soit pas un domaine d’étude à part entière ça a du mal à venir sur le devant de la scène pour être vraiment pris au sérieux.
Mariette : Justement par rapport à l’étranger est ce que vous avez une expérience différente du handicap ?
Mila : Oui justement par rapport à ça, Héloise quand tu as parlé de disabilities studies et de l’Angleterre et de l’Amérique moi j’ai vécu un an à Dublin en Erasmus à Trinity Collège. Déjà la vision du handicap est totalement différente là bas. Ils vont beaucoup plus facilement aider sans se poser de question de manière très volontaire. C’est une mentalité un peu globale. En plus de ça à Trinity College il y a un disability officer, qui est chargé de s’occuper de tout ce qui est en lien avec le handicap sur le campus. Il a une équipe pour l’aider et donc moi quand je suis allée à Dublin je suis allée au Trinity College avant pour visiter le campus et parler avec cet homme là pour parler de mon handicap en lien avec les études. et donc ils m’ont tout de suite expliqué que le campus était accessible, quels étaient mes droits. Il m’a expliqué que par exemple ils étaient en lien avec une société qui permettait d’offrir des aides de vie. C’est une société qui embauche souvent des jeunes filles mais aussi des hommes pour aider les personnes handicapées au quotidien dans différents endroits. Ils nous proposent eux de nous mettre en lien avec leurs aides de vie. C’est beaucoup plus clair, facile qu’en France..
Mariette : Parce qu’ils bénéficient de sorte d’AVS en fait c’est ça ?
Mila : Alors non, elles ne nous accompagne pas scolairement, mais moi par exemple j’ai besoin d’aide le matin pour m’habiller et me préparer donc elles venaient pour m’éviter de me réveiller à 6 h du matin pour mon cours de 8 h parce que ça me prenait 2 heures de me préparer. Ca me faisait gagner du temps, de l’énergie tout ce que tu veux
Mariette : D’accord
Mila : Trinity College c’est un campus, donc il y a des lieux de vie dans le campus, des appartements et des dortoirs. Et il y a des appartements adaptés donc j’ai pu faire la demande d’un appartement adapté. J’ai pu vivre sur le campus ce qui facilite grandement l’accès aux études parce que si j’avais pas eu ça j’aurais dû chercher un appartement dans Dublin qui était accessible. Enfin j’aurais eu du temps de transport le matin donc ça aurait tout changé. Après l’accès à l’appartement, comment dire j’ai dû faire beaucoup de démarches administratives pour l’avoir c’était long et compliqué ! Mais une fois qu’on l’a c’est fini, tu es dans un appartement adapté à tes besoins. Il n’y a plus à se prendre la tête pour la douche le matin.
Mariette : L’aménagement au quotidien te permet de te projeter dans un cursus à l’étranger.
Mila : Tout est différent à l’étranger donc le fait d’avoir tout ça mis en place, qui te facilite la vie parce que vraiment la bas la communication avec les différents acteurs en Irlande est formidable. Ça change tout ! Ça change tout d’avoir une bonne communication, ça change tout ! Et une fois ça a mis très longtemps à être mis en place, j’ai du m’y prendre un an à l’avance mais à partir du moment où c’est fait j’ai plus à me poser de questions.
Mariette : ouais ça roule (rires)
Mila : C’est le cas de le dire haha
Héloïse : alors qu’en France on remet souvent en cause le handicap c’est-à-dire que même si on a fait des démarches l’année passée. Dans la nouvelle année on va redemander mais est ce que tu es bien sourde, ça vient aussi du fait que mon handicap est invisible. Mais au lycée par exemple j’avais une de mes profs qui à propos des études supérieures m’avait dit : Tu sais Héloïse si tu veux faire des études supérieures Héloïse il va vraiment falloir que tu apprennes à entendre et elle ne voyait absolument pas le problème de dire ça à une personne sourde. Une fois que je suis arrivé dans mon école il y a mon responsable pédagogique, à qui j’ai expliqué que c’était compliqué fatiguant et que je pensais à un aménagement et il me répond : Mais Héloise vous ne pourriez pas vous faire implanter, alors que l’implant oculaire est très lourd, ça nécessite de la rééducation etc. Le fait que ce soit méconnu le handicap ça amène à des remarques, à des réflexions qui sont mais très violentes !
Mariette : Très infantilisantes aussi et pathologisantes ? C’est à dire qu’on vous présente toujours comme personne en situation de handicap.
Héloïse : oui totalement
Mila : Non et puis le mot de violence est vraiment bien choisi
Héloïse : Ce qui est violent c’est le côté répétitif et continu, chaque nouvelle personne que l’on rencontre c’est des questions : qu’est ce que c’est ton handicap ? Mais pourtant tu parles bien ! C’est le résultat de pleins de préjugés, de méconnaissance de tout ça et ouais voilà.
Mila : C’est vraiment des exemples très criant de validisme ! Le validisme c’est de manière très large c’est la discrimination dirigée vers les personnes handicapés. C’est des micro agressions répétées, constantes et fatiguantes.
Héloïse : Le problème c’est que quand on est dans un système d’inclusion dit normal et qu’on rencontre un problème lié à notre de handicap dès fois les interlocuteurs vont dire c’est pas possible vous ne pouvez pas être discriminé parce que vous êtes dans un établissement normal. Et en fait c’est un peu ça le problème en France c’est qu’il y a un espèce de mouvement de normalisation des parcours des jeunes en situation de handicap mais sans prendre en compte les spécificités et ducoup le validisme se reproduit encore même dans les lieux d’inclusion ordinaire.
Mila : Nous on entend en permanence vous êtes des personnes ordinaires comme les autres, on vous traite comme des personnes normales. En soi c’est le but mais il ne faut pas nier le handicap qui est présent parce que si on le nie ça devient du validisme.
Héloïse : Il faut réfléchir pour moi en se disant il y a pleins de personnes comment arriver à répondre aux besoins de chacun. Pour moi c’est une illusion de dire que les personnes en situation de handicap il n’y a que celles qui ont des besoins scientifiques, tout le monde à des besoins scientifiques. Alors certes les personnes en situation de handicap ont des besoins plus précis, plus forts etc. Mais si on s’inscrivait davantage dans un paradigme de : on est dans une structure, dans une société ou je ne sais quoi et on essaye de répondre aux besoins de chaque personne tout ce système là de discriminations serait amoindri.
Mariette : C’est assez paradoxale parce que le système éducatif et bon nombre d’institutions veulent faire entrer dans la norme et prétende que ça c’est un type d’intégration alors qu’en pratique le fait qu’il n’y ai pas assez d’aménagements à l’intérieur ça te ramène à ton statut de “hors normes”. C’est une grande hypocrisie quand on regarde à l’intérieur…
Mila : C’est ça ! Les gens veulent à tout prix normaliser, inclure mais il faut le faire en prenant en compte le handicap, parce qu’il est là, il existe.
Héloise : les politiques d’inclusion sociale en france ne prennent pas assez en compte l’entièreté des besoins de la personne ça répond à moitié.
Mila : Comme si on niait une partie de ce qu’on est
Héloïse : C’est ça et du coup ça nous sur handicape contradictoirement !
Mariette : Parce que ça vous rajoute une charge mentale en plus si j’ai bien compris le plus gros problème c’est que même si on met en place des aménagements ils ne sont jamais vraiment adaptés donc ça vous pèse en plus. C’est toujours à vous de vous présenter comme tel et de devoir mettre en place des choses.
Héloïse : Il y a aussi le fait de devoir toujours justifier son handicap ! Moi je suis assez à l’aise avec ça aujourd’hui mais il y a des personnes et je le vois avec les personnes avec qui je travaille aujourd’hui qui ne sont pas forcément à l’aise avec le handicap. Il y a une injonction envers la personne en situation de handicap à être capable de parler de son handicap. A être capable de verbaliser, d’exprimer ses besoins et c’est quelque chose que l’on ne nous apprend pas à l’école en France. Donc parmi les personnes en situation de handicap il y a des personnes qui vont avoir un peu plus de chance parce qu’ils ont appris à le faire ou pas et ça joue beaucoup. C’est tout un processus de conscientisation du handicap et de soi présents pour le monde mais peut être plus pour nous. Et il y a un élément qui peut aider dans cette phase de conscientisation, c’est un peu les acteurs extérieurs. Il y avait plein de choses dont je ne m’étais pas rendue compte jusqu’à ce que je rencontre une association de solidarité étudiante vers qui je me suis dirigée parce que voilà il y a avait un cours ou je n’avais pas de preneur de notes, et le professeur n’était pas du tout compréhensif. Bref je n’allais pas valider ce cours et en fait je leur ai fait un récapitulatif dans mon école et ils m’ont dit mais en fait ce n’est pas normal tout ça. Et des fois quand il y a une autre personne en face de vous, valide, qui vous dit mais en fait ce que tu vis là ce n’est pas normal.
Mariette : pas normal oui
Héloïse : Et bien ça débloque plein de choses, et moi c’est vraiment à partir de ce moment là, où j’ai rencontré cette association et des personnes valides qui m’ont dit mais en fait ça ce n’est pas normal que ça a débloqué plein de trucs et que …
Mila : Les personnes peuvent être valides ou handicapées d’ailleurs hein
Mariette : Et par rapport, là on parle pas mal d’enseignement supérieur, mais vous ne pensez pas comme moi vous qui êtes aussi en sciences sociales que, le plus important il devrait se faire dès le plus jeune âge? Ne serait-ce que pour vous. Enfin à l’école, non mais avoir des cours qui vous font prendre conscience de vos droits et même juste d’apprendre à en parler et apprendre aussi aux valides, tout simplement
Héloïse : Oui voilà ce que je voulais dire c’est qu’il ne faut pas que ce soit des cours juste pour nous
Mariette : Non, non, non
Héloïse : Des cours pour l’ensemble, voilà
Mariette : Évidemment
Héloïse : Mais oui très clairement, ça c’est super important et aussi …
Mila : Il faut qu’on le fasse pour tous et dès le début
Mariette : Parce que ça joue très tôt en fait finalement sur même juste votre rapport aujourd’hui
Mila : Oui complètement
Héloïse : C’est ça, et aussi dans le système en primaire, au collège, au lycée, moi je trouve qu’il y a une chose que les profs devraient obligatoirement faire. C’est, ils ont un élève en situation de handicap, ils doivent proposer la possibilité à l’élève de parler de son handicap aux autres ou que le professeur en parle. Après l’élève il dit oui ou non voilà il fait ce qu’il veut mais moi en primaire, collège, lycée, je n’ai pas eu un seul prof qui est venu me voir en me disant voilà Héloïse est-ce que tu as envie qu’on parle de ta surdité ? Et du coup j’avais toute ma classe qui ne comprenait pas : qu’est-ce que c’était le micro autour du cou, qui ne comprenait pas pourquoi moi je levais souvent la mains, pourquoi je regardais le cahier de l’autre voisin et du coup ils croyaient que je copiais du coup après ça créait des tensions interpersonnels etc. Et ça, proposer en fait cette possibilité là aux jeunes je trouve ça pourrait débloquer vraiment beaucoup de choses.
Mila : Mais si la sensibilisation était faite dès le plus jeune âge comme Mariette le dit il n’y aurait pas ce problème là.
Héloïse : Oui
Mariette : Ce sont des schémas qui se répercutent forcément sur le supérieur
Mila : En primaire, au collège et au lycée ce côté tabou du handicap je l’ai effectivement ressenti parce que soit on me posait aucune question soit on me posait des questions de manière ultra maladroite parce que justement il n’y a pas de sensibilisation qui est faite et on ne se rend pas compte de ce qui peut être blessant ou pas. Et par contre dans l’enseignement supérieur en tout cas pour ma part, du fait aussi de la maturité des personnes qui est un peu plus avancée, il y. Une curiosité qui est quand même présente et mais, de manière avec plus de tact tu vois. Genre les questions sont mieux formulées, et moi il y a des personnes qui se sont vraiment intéressées à mon handicap dans le supérieur et qui m’ont vraiment demandé genre : là est-ce que si je te demande ça, ça te gène ou pas ? Est-ce que si je, est-ce que tu veux que je te propose de l’aide ou pas ? Parce que ça c’est quelque chose par ex que, moi il y a des gens qui m’ont apporté leur aide sans que je leur ai demandé et c’est quelque chose qui est très gênant. Je ne dis pas que le fait d’apporter de l’aide est négatif, ce n’est pas du tout ça, moi je trouve qu’il faut toujours nous demander avant de nous apporter de l’aide.
Mariette : oui je suis d’accord
Mila : Par exemple on m’a déjà aidé à enlever mon manteau sans que je le demande, on me touche en fait quand on m’aide à enlever mon manteau. Et voilà le tôt respect de l’intimité, respect de la sphère personnelle…
Mariette : ce qui relève de l’intégrité en fait, de tes propres choix
Mila : C’est ça n’est pas du tout présent et c’est pour ça moi je pense que ça c’est super important par exemple d’apprendre aux enfants dès le plus jeune âge de demander s’il faut porter de l’aide ou pas.
Mariette : Le consentement en fait !
Mila : le consentement oui de manière générale
Héloïse : et c’est pour ça que je pense aussi que c’est super intéressant cette discussion parce que, ça montre en fait que tous les comportements que l’on doit avoir envers les personnes en situation de handicap c’est pas, ça ne doit pas juste concerner cette sphère là en fait. C’est des questions de manière d’être en général. Comment on vit en société, voilà comment on communique ensemble et moi ce que je dirais c’est pour les personnes valides qui ne savent pas trop comment se comporter avec les personnes en situation de handicap, en fait il faut demander plutôt qu’agir. Après vous verrez bien en face de vous si la personne n’a pas envie de répondre, vous voyez et là dans ce cas là. Peut être qu’il y a des personnes en situation de handicap qui n’ont pas envie d’en parler et bien voilà. Et il faut respecter. Mais le plus important moi je trouve ce n’est pas d’agir et après demander, en fait est-ce que c’était bien ? Et moi par exemple j’ai pas mal travaillé avec des personnes déficientes visuel, et il y a quelque chose que j’ai appris récemment et qui m’a beaucoup beaucoup choqué c’est que les personnes déficientes visuel quand elles traversent quand elles tombent dans la rue par exemple très très souvent mais vraiment 9 fois sur 10 il y a une personne valide qui va prendre le coude, la mains de la personne qui va aider entre guillemets (Mila : ça n’est pas possible ça…) la personne déficiente visuel à traverser alors que la personne elle était en pleine phase de concertation, en train d’écouter les bruits des voitures etc pour savoir quand elle pouvait traverser et la personne ne demande même pas en fait : est-ce que tu veux aller à cet endroit là ? Donc juste demandez, communiquez, je trouve que c’est la meilleure des choses qu’on puisse faire
Mariette : C’est ça ! Communiquer pour redonner en fait l’humanité, parce que quand quelque part quelqu’un vient t’aider sans te demander c’est que tu considère juste la personne comme …
Mila : on a l’impression d’être des objets
Mariette : oui c’est ça !
Héloïse : et en fait la notion qui est vraiment sous-jacente à tout ça comme tu l’as dit Mariette, c’est vraiment le consentement. Je dirais que les personnes en situation de handicap très souvent ont, il nous arrive des choses pas du tout, du tout, du tout consenties. Et c’est un vrai problème en fait. Et je pense que si on pose vraiment le mot consentement, franchement ça peut choquer, surprendre certaines personnes, mais en fait des fois au bout d’un moment il faut poser les mots et dire ce que c’est en fait. C’est juste du consentement.
Mariette : Et ce consentement il passe aussi par, quelque part, une meilleure visibilité même des personnes en situation de handicap dans le sens où, à partir du moment où c’est des personnes valides qui font, sont au sommet des institutions du système éducatif on ne peut pas forcément décréter qu’elles sont inclusives. Dans le sens oui elles ne prennent pas forcément en compte l’expérience propre d’une multitude d’individus qui vivent des choses.. Par exemple ne serait-ce que vos deux situations, un handicap visible ou un handicap invisible on voit bien que …
Mila : Par exemple par rapport à ça, c’est vrai qu’il n’y a pas de représentants de l’État qui sont en situation de handicap, en tout cas pas à ma connaissance, et je sais que par exemple en Amérique, pendant le mandat d’Obama il a engagé une activiste de manière générale dans le milieu du handicap qui s’appelle Judith Heumann qui est une personne handicapée. Et il l’a engagé je crois si je ne me trompe pas, ce qui a permis d’avoir un impact concret sur la vie des personnes handicapées et ça c’est quelque chose je pense qu’il faudrait, que ça arrive on va dire dans pas longtemps en France. Ça serait utile qu’il y ait au moins une personne handicapée qui puisse donner son point de vue sur la situation même si encore une fois voilà, tout handicap est différent et toute personne handicapée vit les choses différemment.
Mariette : C’est ça et ton intervention va m’amener à la conclusion parce qu’on a tout de même bien parlé de, ça soulève un point important c’est à dire que l’éducation a tellement d’importance dans la prise de confiance des individus et dans la prise, qui permette de de se projeter dans un avenir presque gouvernemental de pouvoir, d’empouvoirement on pourrait dire presque. Et justement …
Mila : les représentations aussi
Mariette : les représentations c’est-à -dire qu’il faut donner sa chance à tout le monde et puis il faut donner aussi des perspectives c’est-à -dire ambitieuses à tout le monde. Pour pouvoir prétendre à des postes importants de représentants, de travail dans des associations, en politique pour pouvoir faire avancer les choses. C’est un cycle en fait.
Mila : Comment dire, que quand on ne se voit pas dans les médias et à la télé. Voilà quand on est pas représenté, on a l’impression qu’il y a certaines choses qui ne nous sont pas accessibles en fait. Et c’est pour ça que oui d’avoir des représentants où on se voit en fait on se voit représenté en tant que personne handicapée avec des responsabilités, avec des postes qui vont avoir un impact sociétal important, nous ça nous. Et bien en fait le mot c’est le mot anglais, c’est l’empowerment. Et c’est vraiment cette notion là qui est hyper importante et qui passe effectivement par l’éducation et par notamment l’éducation dans les études supérieures. Il y a tout le problème de ce que l’on appelle « l’inspiration porn » c’est le fait de comment dire de représenter des personnes handicapées comme des personnes inspirantes mais pour des choses qui ne sont pas inspirantes du tout. Et en fait, on nous martèle avec ces représentations-là dans les médias qui sont quand même assez cocasses. Par exemple, et ça ça donne lieu à des situations en tout cas pour moi dans ma vie quotidienne, je suis déjà sortie en boîte et on est venu me voir et on m’a dit : ah lala qu’est-ce-que tu as du courage d’être là. Alors que j’étais en boite. Être pris au sérieux en fait.
Mariette : Oui c’est ça
Héloïse : il faut qu’on soit plus ouvert d’esprit tous. C’est ce que je disais mais voilà, vraiment être plus curieux sur les gens qui nous entourent pour essayer de comprendre leur fonctionnement et essayer de se déconstruire un maximum au quotidien pour voir que non tout n’est pas acquis, tout n’est pas inné. Il y a des choses que certaines personnes font qu’il y en a d’autres ça leur prend des années, et de faire pour ceux qui ont besoin de rééducation etc. Essayer de partir, pas d’oublier tout ce que l’on a appris mais voilà de réussir à avoir un regard critique sur la propre éducation qu’on a pu avoir.
Mariette : de ne pas essentialiser, de communiquer !
Mila : voilà ces petites choses comme ça qui participent à des clichés sur le handicap et qui ne nous mènent pas ensuite à être intégré
Héloïse : Et il faut acheter des masques transparents (rires) !
Mariette : (rires) C’est ça !
Mariette : Et bien je vous remercie beaucoup toutes les deux pour votre témoignage et pour la réflexion qu’on a pu mener ensemble au cours de cette heure. Quant aux auditeurs merci pour votre écoute, vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes audio et sur notre blog où il sera également retranscrit en script N’hésitez pas à prolonger cette discussion en commentaire et à partager ce podcast. À très vite !
Podcast de Mariette Boudgourd, qui n’engage que son auteur-e.