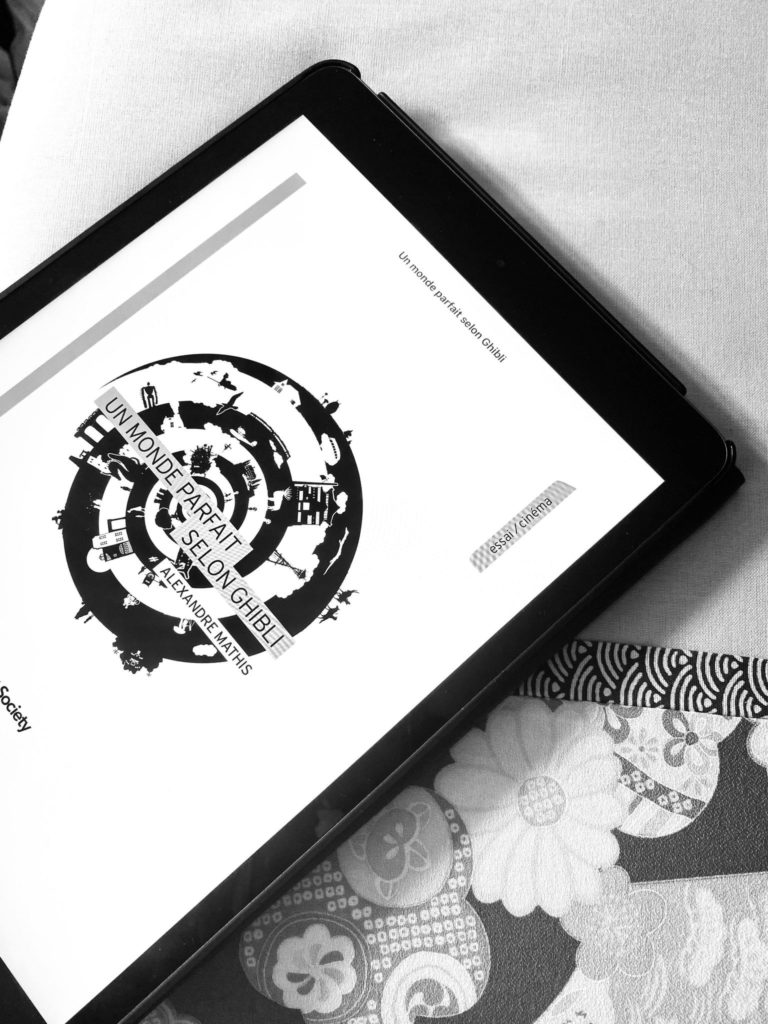En 1998, l’UNESCO décide de classer au patrimoine mondial 71 édifices remarquables qui bordent les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Empruntées tout au long du Moyen-Age par des pèlerins venant de toute l’Europe, ces routes partent de Paris, de Vézelay, du Puy et d’Arles et mènent jusqu’à l’Espagne, à Saint-Jacques de Compostelle.
Il nous faut remonter à l’an 813 pour comprendre les origines du pèlerinage. C’est à cette date que l’emplacement du tombeau de Saint-Jacques est découvert dans le nord-ouest de l’Espagne, un des douze apôtres du Christ qui a converti la péninsule ibérique au christianisme. On raconte que son tombeau aurait été découvert grâce à la lumière des étoiles convergeant vers l’emplacement de sa sépulture, créant une voûte étoilée. Depuis, des milliers de pèlerins font le voyage pour aller s’y recueillir. Cette voûte céleste, souvent confondue avec un fer à cheval, est représentée par les pèlerins le long des nombreux chemins menant à Saint-Jacques de Compostelle, en référence au Saint Patron qui les protège.

Cette gravure date de l’époque médiévale, elle a été réalisée sur un mur de l’hôpital des Pèlerins de Pons en Charente-Maritime. Ce dernier fait partie des 71 édifices classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il constitue un point relais important de la Haute-Saintonge, entre Saintes et Bordeaux, et possède une architecture remarquable. Au Moyen-Age, cet hôpital pouvait abriter jusqu’à trente pèlerins, ce qui est considérable à cette époque, et il accueillait également les mendiants et les enfants abandonnés, qui recevaient des soins dispensés par des chanoines. Une reproduction de ces scènes figure dans l’hôpital, ce qui permet de réellement s’imprégner de l’histoire du lieu, d’autant plus que des instruments de médecine médiévaux sont exposés.

Cet édifice possède une forte valeur patrimoniale, puisque depuis l’incendie de Notre-Dame de Paris, la charpente de l’hôpital des Pèlerins est la plus vieille de France connue, elle date de 1230 ! Son bon état de conservation peut s’expliquer par ses matériaux de construction : du chêne et du châtaignier, deux matériaux imputrescibles (qui résistent au temps et éloignent les insectes !).
C’est aussi l’un des plus vieux complexes hospitaliers d’Europe, puisqu’il a été construit au XIIème siècle sous la demande de Geoffroy III, seigneur de Pons, et nous pouvons encore admirer l’impressionnant porche de style roman qui mesure 18 mètres de haut, dont voici une photographie ci-dessous.


Depuis 2003, des jardiniers se sont employés à reconstituer un jardin de plantes médicinales médiévales ! Il est réparti en carrés de plantes suivant leurs propriétés, des plantes qui étaient bien entendu utilisées dans l’hôpital pour soigner les malades. On y trouve plus d’une centaine d’espèces !
Si l’édifice apparait aujourd’hui sous son plus beau jour, c’est parce qu’il a été restauré en 2004. A cette occasion, les vitraux ont été refaits par le maître-verrier Jean-Dominique Fleury avec une approche artistique originale. Son projet s’inspire des portails sculptés romans des églises saintongeaises qui jalonnent la route de Saint-Jacques de Compostelle. Les motifs de ces sculptures, végétaux, rinceaux, entrelacs, sont reproduits en silhouettes sérigraphiées à différentes échelles sur les vitraux, ce qui lui fait dire :
« Des traces du chemin, j’ai décalqué quelques signes, empruntés ici ou là à un portail roman, un ciel de sable. D’un soleil d’or, la couleur s’est ici posée. »



L’Hôpital des Pèlerins est aujourd’hui ouvert au public tous les étés, et sur réservation auprès de l’office de tourisme le reste de l’année. Depuis l’année 2020, il est également devenu un musée archéologique ! En effet, il abrite une collection d’objets allant de l’Antiquité à l’époque moderne, qui proviennent de Pons et ses alentours. Le musée et l’hôpital des Pèlerins se favorisent mutuellement et l’été 2020 a été marqué par une augmentation considérable du nombre de visiteurs !
Si cet article vous a intéressé, nous vous invitons à vous abonner au compte Instagram de l’Hopital des Pèlerins : hopital_des_pelerins_museepons, et pourquoi pas, à venir en Charente-Maritime pour le visiter !
Article de Manon Etourneau
Cet article n’engage que son auteure.