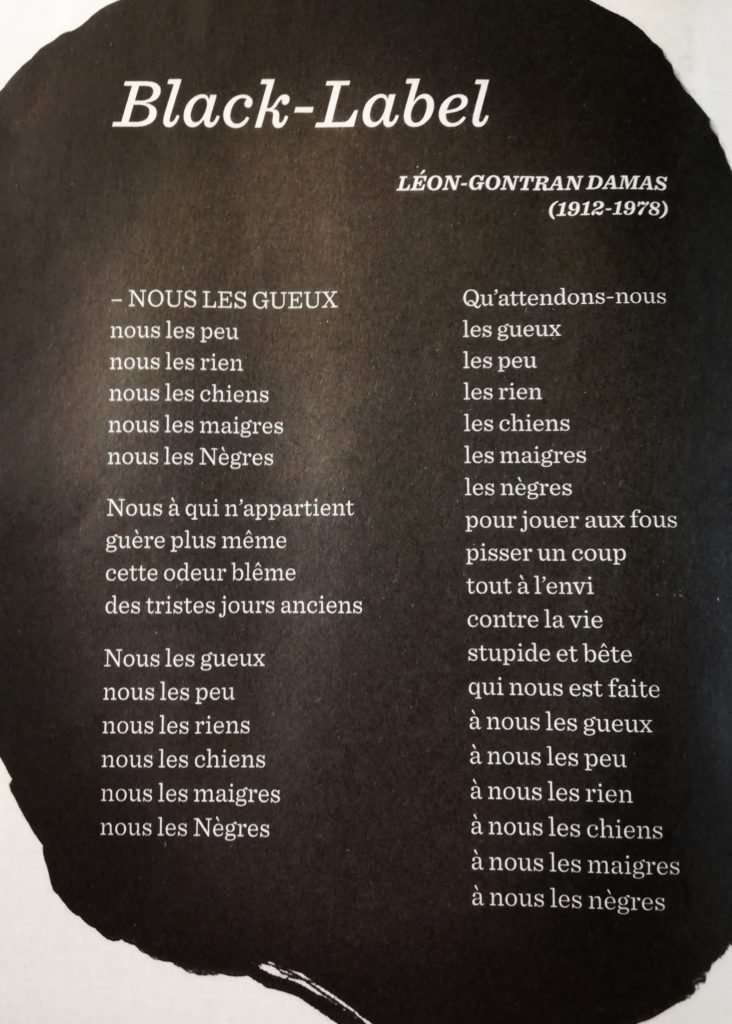Milan Kundera est l’un des auteurs les plus lus au monde. Cependant, il a toujours été très discret, et n’a pas donné d’interview depuis 1986. À travers l’ensemble de son œuvre, il explore l’ironie de la vie dans un contexte de communisme, mais aussi toute la profondeur de l’âme humaine en intégrant à la fable romanesque, de grandes réflexions. Ce qui rend sa lecture agréable c’est la façon dont il pose des situations, des réflexions, mais sans jamais imposer une vérité.
Il est né en 1929, en Tchécoslovaquie, dans la ville de Brno, réputée notamment pour ses théâtres et opéras. Son père était pianiste et musicologue. Il a donc grandi entouré de musique, et particulièrement de musique traditionnelle.
Il est ensuite parti étudier à Prague, avant de devenir professeur d’histoire du cinéma, à l’Académie de musique et d’art dramatique, puis à l’Institut des hautes études cinématographiques à Prague.
Il écrit ses premiers textes, dans les années 1950. En 1968, des centaines de chars soviétiques arrivent dans Prague, restreignant toutes libertés. En 1975, l’auteur s’exile en France, où il est naturalisé en 1981. Il écrit d’abord en Tchèque, puis à partir de 1993, il écrit exclusivement en français.
Milan Kundera a reçu de nombreux prix, été cité plusieurs fois sur les listes du prix Nobel de la littérature et son œuvre a été traduite dans 49 langues. Aussi, il fait partie des 7 auteurs à être entré dans la pléiade de son vivant.
Son inspiration, il l’a puisée dans la Tchécoslovaquie et dans le communisme.
De sa ville de naissance, il a gardé son amour pour la musique, qu’on retrouve par exemple dans La plaisanterie, témoignant que la musique traditionnelle est porteuse de traditions très anciennes.
Ensuite, sa principale source d’inspiration est Prague. En effet, il arrive à Prague dans un contexte où le communisme apparait comme le meilleur futur possible. Cependant, le stalinisme est rapidement venu étouffer cette ville, cœur de l’histoire multiculturelle de l’Europe centrale et la spontanéité de sa vie culturelle et amoureuse. Écrivant dans les cafés de Prague, la première inspiration de Kundera est le couple. Dans ses premiers livres, des recueils de poèmes lyriques, il vient déconstruire la culture stalinienne en mélangeant l’ironie et le ludique. Ainsi, il a proposé une nouvelle image du couple, dans laquelle il oppose la pesante tragédie à la légèreté du jeu.
De la façade de l’hôtel de ville, jamais réparée après sa destruction par les allemands, associée au souvenir de sa mère, il fait une métaphore de l’exhibition des souffrances. Il transcrit cette idée dans L’insoutenable légèreté de l’être, dans le personnage de Thérésa. C’est un thème récurrent avec Kundera ; ses personnages sont souvent dans des situations ou univers où tout se développe sous eux. Ils se retrouvent dans un vide, qu’ils ne connaissent et comprennent pas.
Dans L’insoutenable légèreté de l’être il affirme aussi qu’ « il y a des idées qui sont comme un attentat ». Cette citation se rattache incontestablement au rôle intellectuel qu’il a eu contre le régime communiste en Tchécoslovaquie. Il créé des personnages témoins de la « fête de la haine », expression qu’il utilise pour parler de l’invasion russe ayant mis fin au « Printemps de Prague ». Il raconte par exemple, la résistance des pragoises armées seulement de leurs mini-jupes et du drapeau national face aux chars soviétiques ; la surveillance dont il faisait l’objet, avec sa femme Vera ; ou encore l’obligation de quitter Prague qui était « devenue laide ».
Malgré des images négatives s’inspirant d’un contexte pesant, il écrit avec légèreté et éprouve le désir constant d’incorporer des touches d’humour.
La fête de l’insignifiance est l’illustration parfaite de cette idée. Ce roman est considéré par l’éditeur Adelphi « comme une synthèse de tout son travail […] inspirée par notre époque qui est drôle parce qu’elle a perdu tout sens de l’humour ».
Déjà dans L’immortalité, il met en scène Goethe et Hemingway qui se promènent pendant plusieurs chapitres, discutant, s’amusant. Ensuite, dans La lenteur, sa femme Vera le met en garde : « Tu m’as souvent dit vouloir écrire un jour un roman où aucun mot ne serait sérieux. […] Je veux seulement te prévenir : fais attention. »
Ce roman, Milan Kundera le publie en 2013. La fête de l’insignifiance, semble en effet au premier abord à l’opposé du sérieux. Il est court, léger, se lit facilement, fait l’éloge de l’insignifiance. Mais ce roman peut en réalité être classé comme un roman philosophique. Il y dresse notamment un Staline, plus grands meurtriers du XXe siècle, sous un jour léger et un ton insignifiant, dans lequel il raconte une histoire invraisemblable, que ses camarades prennent au premier degré, sans comprendre qu’il s’agit d’une blague. Loin de vouloir rendre le personnage sympathique il pointe en réalité du doigt l’entrée dans l’ère du sérieux, du tout politique. Il écrit de façon isolante et avec une liberté sans filet sur une partie enfouie de Staline éprouvant de l’attachement pour un certain Kalinine, sur des questionnements totalement farfelus sur la futilité des droits de l’homme ou sur le nombril et les statuts des reines du jardin du Luxembourg, …
Ces épisodes anecdotiques de l’ouvrage traduisent en réalité son ensemble. Pour reprendre l’expression de l’éditeur Adelphi, il est « inspiré par notre époque qui est drôle parce qu’elle a perdu tout sens de l’humour ».
« Nous avons compris depuis longtemps qu’il n’était plus possible de renverser ce monde, ni de le remodeler, ni d’arrêter sa malheureuse course en avant. Il n’y avait qu’une seule résistance possible : ne pas le prendre au sérieux. » ?
Article de Charlotte Gutmann
Cet article n’engage que son auteure